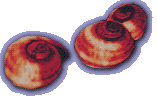 Mener grand train
Mener grand train
 Dimanche
6 juin. Paris. Fin de soirée.
Dimanche
6 juin. Paris. Fin de soirée.
 Métro
bondé, les portes se referment dans un chuintement.
Je m’assois sur ma valise, un peu fatigué, tout
juste conscient de ce qui se passe autour de moi. Station
suivante. Descente de voyageurs et de nouveau la foule qui
se fraye un passage. Un musicien se glisse dans le wagon,
il peut à peine bouger, du coup c’est juste devant
moi qu’il accorde son violon. Puis qu’il amorce
une mélodie classique, sans que j’arrive à
identifier s’il s’agit de Bach ou de Mozart. Seule
certitude : c’est beau. Spectateur privilégié,
je ne le quitte pas des yeux quand les parisiens qui m’entourent
font au contraire tout pour l’ignorer. La lassitude
de se voir sans cesse solliciter, sans doute. Pour ma part
ce jour-là, j’ai béni ma candeur de provincial.
Métro
bondé, les portes se referment dans un chuintement.
Je m’assois sur ma valise, un peu fatigué, tout
juste conscient de ce qui se passe autour de moi. Station
suivante. Descente de voyageurs et de nouveau la foule qui
se fraye un passage. Un musicien se glisse dans le wagon,
il peut à peine bouger, du coup c’est juste devant
moi qu’il accorde son violon. Puis qu’il amorce
une mélodie classique, sans que j’arrive à
identifier s’il s’agit de Bach ou de Mozart. Seule
certitude : c’est beau. Spectateur privilégié,
je ne le quitte pas des yeux quand les parisiens qui m’entourent
font au contraire tout pour l’ignorer. La lassitude
de se voir sans cesse solliciter, sans doute. Pour ma part
ce jour-là, j’ai béni ma candeur de provincial.
 Quatre
stations plus tard, j’étais le seul à
applaudir au concerto. Les autres voyageurs m’observaient
avec un rien d’inquiétude et de désapprobation.
Mais je n’en avais cure. A quoi bon la vie s’il
faut en proscrire l’enthousiasme ?
Quatre
stations plus tard, j’étais le seul à
applaudir au concerto. Les autres voyageurs m’observaient
avec un rien d’inquiétude et de désapprobation.
Mais je n’en avais cure. A quoi bon la vie s’il
faut en proscrire l’enthousiasme ?
 Le
musicien a lâché un grand rire et s’est
mis à saluer avec emphase. Alors je me suis levé
tout en continuant à applaudir, de plus en plus fort,
comme pour un rappel. Une standing ovation en catimini, mais
qui a réveillé le wagon dans sa torpeur. Puis
le chuintement de l’ouverture nous a ramené aux
contingences du réel. J’ai saisi ma valise, fouillé
dans mes poches. Mal à l’aise j’ai senti
le billet de banque qui trainait là à défaut
de la pièce attendue. Vague hésitation. Puis
dans un sourire à la joie de l’instant, j’ai
lâché mon aumône dans le chapeau, alors
que les portes claquaient.
Le
musicien a lâché un grand rire et s’est
mis à saluer avec emphase. Alors je me suis levé
tout en continuant à applaudir, de plus en plus fort,
comme pour un rappel. Une standing ovation en catimini, mais
qui a réveillé le wagon dans sa torpeur. Puis
le chuintement de l’ouverture nous a ramené aux
contingences du réel. J’ai saisi ma valise, fouillé
dans mes poches. Mal à l’aise j’ai senti
le billet de banque qui trainait là à défaut
de la pièce attendue. Vague hésitation. Puis
dans un sourire à la joie de l’instant, j’ai
lâché mon aumône dans le chapeau, alors
que les portes claquaient.
 Un
jour dans ma vie, pendant 6 minutes, j’ai eu droit un
concert privé.
Un
jour dans ma vie, pendant 6 minutes, j’ai eu droit un
concert privé.
 Un jour dans ma vie, je me suis offert le luxe du mécénat.
Un jour dans ma vie, je me suis offert le luxe du mécénat.
 Un
jour dans ma vie, j’ai couru vers un train en goutant
la saveur de Paris.
Un
jour dans ma vie, j’ai couru vers un train en goutant
la saveur de Paris.











